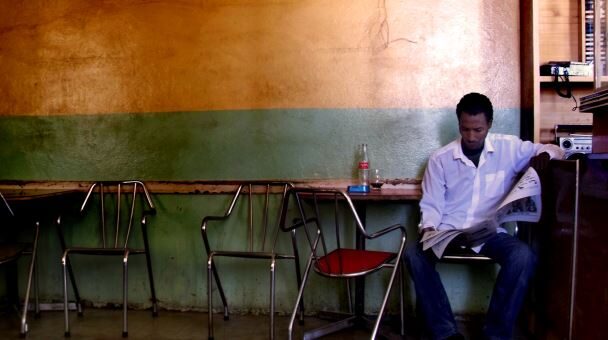Le Brexit fait énormément parler de lui depuis deux ans. Au-delà d’un vote anti-immigration, il est davantage le signe d’une population écrasée sous le poids de l’austérité. Ces inégalités sociales ne sont pas le propre des Britanniques, comme l’indique le mouvement des Gilets jaunes en France, par exemple. L’Europe parvient-elle à saisir ce profond mal-être ? Comment gère-t-elle ce fonds de colère qui profite aux partis populistes ?
Si l’on en croit les sondages, le paysage politique européen post-élections sera beaucoup plus morcelé qu’aujourd’hui. Les Sociaux-Démocrates perdraient du terrain au profit des groupes eurosceptiques. Les Verts stagneraient, les Libéraux seraient en perte de vitesse [1]GUITTON et KAKON, « A quoi ressemblera le futur Parlement européen ? ». . Plusieurs éléments planent dans l’air et vont être déterminants pour la prochaine configuration européenne.Documents joints
Notes[+]
| ↑1 | GUITTON et KAKON, « A quoi ressemblera le futur Parlement européen ? ». |
|---|---|
| ↑2 | Le sondage a porté sur 10 pays européens dont la France, la Grèce, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni. |
| ↑3 | BUISSON M., « Eurosceptiques et populistes se frottent les mains en attendant 2019 ». |
| ↑4 | RICARD Ph., « L’immigration, un sujet d’inquiétude parmi d’autres pour les européens ». |
| ↑5 | Pour aller plus loin, voir analyse de Justice et Paix. |
| ↑6 | MASON P., « les raisons de la colère ». |
| ↑7 | Ibid. |
| ↑8 | Voir l’analyse de Justice et Paix. |
| ↑9 | Appel de la première « assemblée des assemblées des Gilets jaunes ». |
| ↑10 | GUENOLE Th., « Calomnier les Gilets jaunes, la stratégie ignoble et bien rôdée de Macron ». |
| ↑11 | Oxfam, « Le piège de l’austérité, l’Europe s’enlise dans les inégalités ». |
| ↑12 | CHARREL M., « Inégalités : les écarts de revenus ont augmenté partout en Europe. |
| ↑13 | ALBERTINI D., « Oups, le FMI s’est trompé sur l’austérité ». |
| ↑14 | PIKETTY Th., « Reconstruire l’Europe après le Brexit ». |