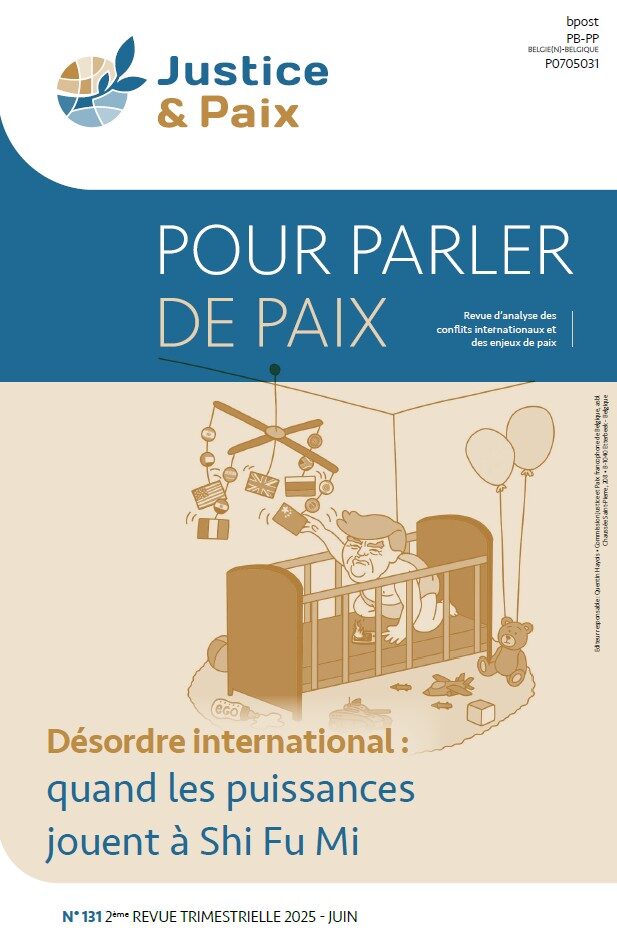Depuis plus d’une cinquantaine d’années, des chercheurs et chercheuses alertent sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Divers scénarios avancent que, dans un avenir proche, ce seront les technologies qui règleront ce problème. Fausse bonne idée ?

Crédit : Dmitry Ganin
Depuis plus d’une cinquantaine d’années, des chercheurs et chercheuses alertent sur les limites écologiques et climatiques du modèle de développement des sociétés humaines et sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Face à ces enjeux, diverses conférences internationales et COP ont eu lieu, engendrant notamment l’accord de Paris de 2015, un traité juridiquement contraignant qui impose à ses 193 parties de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C d’ici à la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle et même, de préférence, à 1,5 °C. Pour ce faire, la neutralité carbone[1] devient le nouvel objectif à atteindre.
Cependant, les quantités d’émissions de gaz à effet de serre de la majorité de ces pays sont jusqu’à présent très éloignées de la neutralité carbone. À l’échelle internationale, les émissions ont même pratiquement été multipliées par trois depuis 1960. En conséquence, atteindre la neutralité carbone supposerait de diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à 1990.
Comment arriver à limiter l’émission des gaz à effet de serre et, ultimement, espérer limiter l’ampleur du changement climatique et les impacts environnementaux ?
En réponse à cette question, divers scénarios avancent que, dans un avenir proche, ce seront les technologies qui règleront ce problème, tout en proposant à la clé de maintenir le même niveau – ou plus – de consommation. Fausse bonne idée ?
Le technosolutionnisme ou la croyance en une solution technologique qui résoudra nos problèmes
Pour 2050, l’agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit de parvenir à un scénario « zéro net », neutre en carbone, grâce au développement de diverses technologies, dont le captage direct du carbone dans l’air et son stockage. L’idée serait de capter et de retirer le CO2 de l’atmosphère à l’aide de grands « aspirateurs » ou de capturer les fumées à la sortie des cheminées des usines. D’autres scénarios se basent sur l’hypothèse de la découverte de nouvelles technologies, sur la composition de matériaux plus résistants, ou encore sur l’hypothèse que certaines manipulations chimiques seront possibles à l’avenir.
Tous ces scénarios peuvent être regroupées sous la notion de « technosolutionnisme », appelé également solutionnisme technologique.
Cette notion a émergé en 2014 dans le débat public, à partir de l’ouvragePour tout résoudre, cliquez ici, du chercheur américain d’origine biélorusse Evgeny Morozov. L’auteur y met en lumière des projets des entrepreneur·ses californien·nes du numérique qui ambitionnent de « réparer tous les problèmes de ce monde ». Selon lui, l’idéologie sous-jacente derrière la plupart des discours et pratiques sur le numérique serait le « techno-enthousiasme », c’est-à-dire l’idée selon laquelle les nouvelles technologies pourraient améliorer tous les aspects de notre vie, de la démocratie à notre cuisine, en passant bien sûr par le changement climatique.
La pensée technosolutionniste a cependant de nombreuses limites. Nous nous attacherons ici à nous focaliser sur notre sujet de base, à savoir les impacts environnementaux et climatiques, mais nous vous invitons à effectuer de plus amples recherches si le cœur vous en dit.
Les limites du technosolutionnisme
Tout d’abord, la limite principale du solutionnisme technologique est qu’il repose sur un certain nombre d’hypothèses, dont certaines semblent tout à fait inaccessibles. En effet, de nombreuses solutions potentielles se basent en fait sur l’utilisation de technologies qui n’existent pas encore pour le moment et ne sont qu’au stade du prototype.
Si on prend l’exemple de la captation de CO2, que nous avons évoqué précédemment, nous nous apercevons vite en faisant quelques recherches que les performances actuelles en la matière sont loin de celles qui sont présentées dans les projections. En effet, alors que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) fixe le niveau de captage du carbone par les technologies de captation et de séquestration de CO2 à seulement 15% des efforts de réduction des émissions pour atteindre la neutralité du secteur de l’énergie en 2070, la réalité nous montre que ces technologies ont plutôt tendance à augmenter les émissions de CO2. Dès lors, le technosolutionnisme se baserait souvent sur des solutions fantasmées ou qui n’ont pas encore fait leurs preuves dans une longue durée.
Outre les impacts dans le temps, les moyens financiers, la dépendance à des ressources qui se raréfient, la non prise en compte du contexte international sont d’importantes limites au solutionnisme technologique. Ce qui lui est souvent reproché est donc de ne pas être systémique et de ne pas tenir compte des conditions réelles dans lesquelles ces technologies se déploieraient, ou encore de considérer les questions de dérèglement climatique sous le prisme de l’empreinte carbone, ce qui minimise le problème.
Les impacts de l’usage des technologies sur l’environnement
Outre le fait de comporter des limites dans leur champ d’application, les technologies sont la cause de nombreux impacts négatifs sur l’environnement, ce qui est plutôt contreproductif avec l’idée de s’en servir pour le préserver.
Dans notre étude « Les fausses promesses du numérique », de 2019, nous mentionnions déjà le rapport SMART 2020 de l’initiative Global e-sustainability Initiative (GeSI) qui avançait que le déploiement des technologies de l’information et de la communication permettrait de réduire de 15 à 30% nos émissions de gaz à effet de serre et de limiter le réchauffement climatique d’ici à fin 2020. Or, rien de tel n’a pu être observé, bien du contraire. La part du numérique dans les émissions de GES mondiales a augmenté de moitié depuis 2013 et représente aujourd’hui 4% des émissions, tous secteurs confondus.
Cela peut notamment être expliqué par le fait que, bien qu’il soit concevable d’envisager que la technologie du numérique aurait pu réduire par exemple l’impression de feuilles en papier ou d’autres coûts liés à la communication, cela est sans compter les impacts cachés des technologies sur l’environnement, comme la production d’énergie nécessaire à créer, entretenir et utiliser les appareils et la consommation liée aux énormes data centers.
Différents effets peuvent également advenir en raison du recours massif aux technologies :
- L’effet rebond : l’amélioration des technologies fait en sorte que l’on consomme plus de ressources et d’énergies. Par exemple, comme l’ordinateur nous permet de moins imprimer de papier, on imaginera que l’on est plus écolo et on utilisera notre ordinateur pour tout et rien (ce qui consomme en réalité énormément). Un autre exemple est d’installer des panneaux solaires qui font baisser notre consommation, mais de laisser la lumière allumée car on pense que l’on consomme mieux. Comme on a l’impression de mieux consommer grâce à des technologies plus efficientes, on va dès lors inconsciemment consommer tout autant, si pas plus.
- Le paradoxe de Jevons : il s’agit de l’effet rebond poussé à l’extrême. Dans ce cas, plus il y a de nouvelles technologies rendant efficace la consommation d’une ressource, plus la demande pour cette ressource augmente.
- L’effet parc : remplacer quelque chose qui existe déjà implique de changer des chaînes de productions, d’infrastructures, etc. et est donc coûteux en matériaux et énergie. Un exemple est la voiture électrique, où l’on change tout le parc automobile avant d’avoir épuisé la durée de vie de l’ancien modèle.
Par ailleurs, le recours aux technologies demande toujours plus de ressources, notamment de métaux qui sont omniprésents. L’idée d’un « capitalisme vert » où l’on maintiendrait toujours plus de croissance, tout en ayant recours aux technologies pour limiter notre impact, serait donc dépendante de l’extraction minière… un secteur qui a énormément d’impacts sur l’environnement et les populations. A ce stade, le serpent se mord donc la queue…
Questionner véritablement notre modèle de société
Face aux constats énoncés, nous pouvons donc finalement nous poser la question de la procrastination face aux crises environnementales. Le technosolutionnisme serait-il une manière d’éviter de se pencher sur la complexité du monde ? Ou encore de se voiler la face en essayant de conserver un certain niveau de confort ?
A l’heure où des actions fortes sont plus que nécessaires pour préserver nos écosystèmes, il est nécessaire de se questionner réellement sur l’utilité de nos choix de production et de consommation, mais également sur le modèle de société que nous souhaitons. A-t-on réellement besoin de voitures électriques qui soient des voitures toujours plus équipées et individuelles ou doit-on plutôt repenser en profondeur notre manière de nous déplacer, de vivre ?
Cela implique d’amorcer des réflexions sur la manière dont on repense les services publics, mais également la répartition des richesses et des ressources à l’échelle globale, dans une optique systémique, ou encore de repenser le système démocratique et de rendre la technologie plus concrète et la discuter.
Au lieu de miser sur le technosolutionnisme, il s’agirait dès lors de miser sur la sobriété, entendue comme « une recherche de modération dans la production et de la consommation de biens et de services nécessitant des ressources énergétiques ou matérielles ». Au lieu d’attendre que des technologies résolvent nos problèmes, nous nous devons de de faire le choix politique de questionner les usages individuels et l’organisation sociale, en passant notamment par la low tech, et ainsi nous ancrer justement dans le monde, en tenant compte de ses limites.
Sarah Verriest.
[1] Cette neutralité carbone est définie comme « l’équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre ».