Les discriminations structurelles, héritières de l’ancien système colonial européen, sont encore présentes aujourd’hui dans la société. La justice sociale étant au centre de notre réflexion, le rôle de l’éducation est primordial afin de former les prochaines générations à ne pas répéter les erreurs du passé et à se fixer comme idéal une société plus égalitaire, et ce à tous les niveaux.
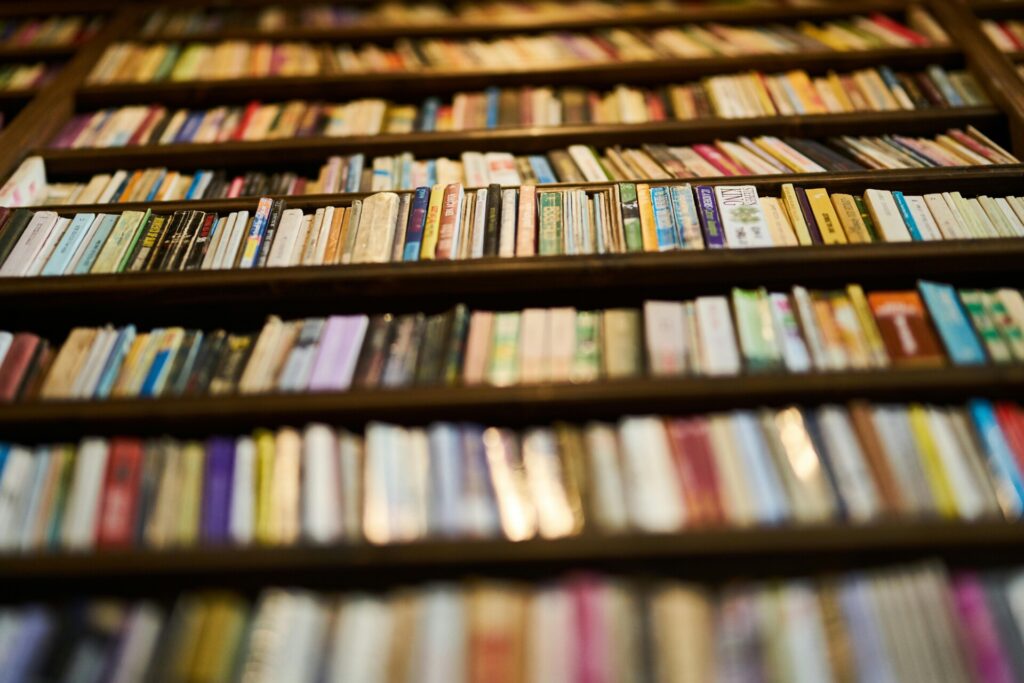
Nous sommes le 7 juin 2020, plus de 10.000 manifestant·es marchent en direction du Palais de Justice de Bruxelles dans le but de réclamer la fin des violences policières, en particulier contre les personnes racisées[1]. Cette marche fait écho au mouvement Black Lives Matter né quelques années auparavant aux États-Unis et ayant atteint son point culminant lors de la mort de Georges Floyd dont le supplice fit le tour des réseaux sociaux. Partout dans le monde, des citoyen·nes prennent part à la dynamique et défilent dans les rues pour réclamer justice à la vue de toutes ces bavures policières, signe d’un système inégalitaire basé sur les différences de traitement quant à la couleur de peau. Par la suite, un phénomène va naître, parallèlement à ces revendications : la mise en cause de tous les personnages historiques ayant participé à un système d’oppression qui conduira à la question de la suppression de toute trace de leur passage dans la société contemporaine. De Léopold II à Colbert en passant par Christophe Colomb, tous ces symboles coloniaux feront l’objet d’un débat public pendant des semaines, suscitant diverses réactions dans les sociétés occidentales. Au fil des discussions, bien des idées vont émerger afin de sensibiliser les nouvelles générations à la problématique du poids de l’histoire coloniale sur la question des discriminations structurelles.
Comprendre l’origine des inégalités structurelles
Pour mieux comprendre les origines d’une société fracturée, il faut bien souvent remonter dans l’histoire et cerner les prémices ayant conduit à une telle situation. Pour ce qui est des inégalités sociales en Belgique, elles tirent essentiellement leurs sources du chapitre colonial. Mais quel est le rapport entre colonialisme et discriminations structurelles ?
Dans l’absolu, le colonialisme prônait le principe que les grandes nations industrialisées du XIXe siècle avaient le devoir de « civiliser » les nations étrangères au mépris des structures sociales existantes. Qui dit mission de civilisation dit contact avec des peuples présentés comme « sauvages » et donc mise en évidence de stéréotypes profondément racistes venant conditionner les mentalités des populations. Dans tous les domaines de la société tels que la vie politique, l’art, la musique, les stéréotypes coloniaux vont s’immiscer dans l’imaginaire populaire présentant les peuples colonisés comme étant naïfs, craintifs, fainéants tandis que le Blanc est présenté comme ce maître naturel de la société[2]. Les exemples des zoos humains à Tervuren mettant en avant la reconstitution d’un village congolais (exposition de Bruxelles 1958) ou encore de la célèbre bande dessinée d’Hergé Tintin au Congo (1957) résument parfaitement à eux seuls la pensée coloniale belge de l’époque concernant les Congolais·es. Ainsi, cette aventure coloniale posera les bases d’une discrimination sociale voulue, généralisée et déshumanisante pour les peuples étrangers. La résultante est que la justice sociale, définie comme étant une égalité d’accès pour toutes et tous aux droits socioéconomiques tels que l’accès à l’emploi, à un logement décent, à une justice impartiale ainsi qu’aux soins de santé adéquats, restera un défi quotidien principalement pour les personnes d’origine africaine et asiatique. À titre d’exemple, sur le marché de l’emploi, à CV égal, les personnes ayant des noms à consonance étrangère se verront plus souvent refuser un emploi au profit des personnes ayant des noms purement « belge »[3]. La dynamique sociale se fonde encore sur ce rapport entre groupe dominant et groupe dominé, créant une fracture sociale entre les citoyen·nes. Cette fracture établie sur des décennies d’injustices sociales posera les bases de ce qu’on appelle aujourd’hui le racisme systémique ou structurel. Le racisme systémique est défini comme étant :
La notion selon laquelle les structures sociales reproduisent des inégalités basées sur la discrimination raciale. Ainsi les personnes racisées subissent des défis liés au racisme non seulement de la part d’individus, mais également de systèmes (santé, éducation, carcérale, etc.).[4]
Toutefois, il faut rester objectif·ve et préciser qu’il ne s’agit pas spécialement d’une volonté délibérée de la part des structures sociales d’appliquer un tel schéma, mais plutôt d’un phénomène profondément ancré dans la culture. Le poids de l’histoire n’est pas un facteur à négliger, car il est constitué de faits que l’État doit assumer et regarder en face afin de pouvoir trouver les solutions adéquates et promouvoir une inclusion totale.
Transmission incomplète de l’histoire dans le système éducatif
Dans une société socialement fracturée, où le degré d’accès aux droits socioéconomiques est trop souvent déterminé par les origines des personnes, l’école reste le premier domaine où il est possible de remettre les compteurs à zéro, de façon à reconstruire un cadre propice au développement de mentalités plus tolérantes et plus inclusives. Le domaine de l’apprentissage est, à lui seul, un défi majeur pour la simple et bonne raison, qu’à titre d’exemple, les inégalités sur le marché du travail commencent déjà sur les bancs de l’école. Cependant, tout ceci n’est réalisable qu’à condition de mettre en place un programme scolaire axé sur le progrès social en privilégiant un apprentissage complet pour les jeunes générations.
Concernant la Belgique, l’apprentissage du chapitre colonial reste un détail dans le système éducatif. Premièrement, celui-ci n’est pas obligatoire dans le programme scolaire. De ce fait, beaucoup d’élèves sortent des bancs de l’école sans spécialement savoir que la Belgique a colonisé l’actuelle République démocratique du Congo, mais aussi le Rwanda et le Burundi[5]. De plus, le temps d’apprentissage de ce même chapitre ne représente qu’une infime partie dans l’horaire principal des élèves. Cet état de fait donne l’impression que le passé colonial n’est qu’un détail de moindre importance dans la vie sociale, or ce même passé est toujours source de grandes frustrations. Deuxièmement, force est de constater que la plupart des manuels d’histoire sont anciens et n’ont pas encore été mis à jour afin d’offrir un schéma complet aux élèves de primaire et de secondaire[6]. En effet, dans les anciens manuels, le plus célèbre des rois des belges est présenté comme ce grand « bâtisseur » or aujourd’hui certain·es le classent parmi les plus grands criminels du XXe siècle, d’où la question d’enlever toute représentation du roi dans l’espace public. La fracture sociale se fait ressentir à ce niveau-là également : comment présenter les personnages centraux de l’époque coloniale ? Lorsque les enfants apprennent dès leur plus jeune âge que la société se fonde automatiquement sur un rapport dominant dominé cela alimente un fossé social, lui-même vecteur d’inégalités dans leur vie de futur·es adultes. Il nous faudra attendre 2027 pour voir arriver de nouveaux manuels donnant une vision plus juste de la colonisation, et ce n’est qu’à partir de ce moment-là que nous pourrons constater les effets de la réforme éducative sur les mentalités collectives en Belgique.
Pistes d’action pour une société réconciliée
Au XXIe siècle, la quête de justice sociale ne se limite plus uniquement qu’à une volonté d’équité socioéconomique entre les citoyen·nes, il y a également les questions de justice climatique qui représentent un enjeu vital au cœur de l’actualité. À cela nous sommes venu·es ajouter la question de justice historique, désignant un rétablissement de l’entièreté des faits ayant façonné une nation. Il ne s’agit pas de qualifier les gentil·les et les méchant·es, mais plutôt d’apporter la vision la plus juste possible de façon à mettre en avant les diverses responsabilités, mais aussi et surtout les solutions adéquates aux divers problèmes rencontrés. Cette démarche passe par trois niveaux :
Par l’action citoyenne. Ce premier niveau passe par la détermination des citoyen·nes à réclamer la vérité sur tous les faits historiques de la colonisation et les effets sociaux qui sont nés de ce chapitre. Les revendications au début de l’été 2020 sont la preuve qu’une mobilisation sociale, qu’elle se passe dans les rues ou sur les réseaux sociaux pose des actions concrètes qui ont une forte répercussion sur l’agenda des décideur·euses.
Par la volonté politique. Ce second niveau fait intervenir une volonté assumée de la part des décideur·euses de regarder le passé en face afin de déterminer le degré de responsabilité de chaque acteur·rice dans celui-ci, mais aussi, et surtout de trouver les solutions adéquates aux inégalités structurelles qui sont encore ancrées dans la culture européenne. Nous avons l’exemple du rapport du comité spécial chargé d’examiner les faits de la colonisation belge (2021) qui n’a pas rencontré la popularité espérée au départ, par manque de dialogue politique visant à faire toute la lumière sur le passé colonial.
Par des réformes dans l’éducation. Ce troisième niveau est influencé par les deux précédents car il est une addition d’action citoyenne et de volonté politique visant à réformer le système éducatif afin d’apporter plus d’exactitudes sur les faits déroulés, de présenter une vision plus complète du passé colonial sans automatiquement désigner les bons, les mauvais et ainsi de remettre les principes de justice sociale au centre de l’apprentissage des prochaines générations.
C’est essentiellement par ces trois niveaux-là que cette justice historique pourra venir rajouter une plus-value à la justice sociale pour plus d’équité dans notre société.
Philippe Kamitatu Etsu.
[1] C.S. (2019) « Black Lives Matter » : près de 10.000 personnes se sont rassemblées devant le Palais de Justice de Bruxelles. Le Soir.
[2] Delisle Philippe (2019). « Le reporter, le missionnaire et ‘l’homme-léopard’. Réflexions sur les stéréotypes coloniaux dans l’œuvre ». Persée
[3] UNIA (2022). « Monitoring socioéconomique : Marché du travail et origine ». UNIA
[4] Takwa Souisi (2022). « Racisme Systémique au Canda ». The CanadianEncyclopedia
[5] Houssonloge Dominique (2020). « Notre histoire coloniale est-elle suffisamment enseignée ? » UFAPEC.
[6] BX1 (2021). « L’histoire coloniale de la Belgique à l’école : les nouveaux référentiels sont attendus pour … 2027 ». BX1 Média de Bruxelles.





