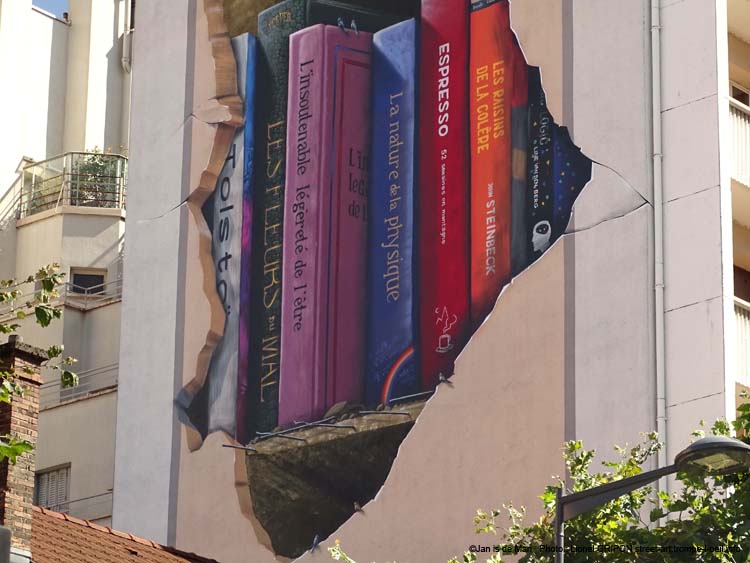L’ordre international connait de jour en jour des épisodes de tensions entre États en raison des rapports de pouvoir ou de force toujours croissants et conflictuels, sans que le droit dont la fonction est de les réguler ne puisse y jouer pleinement son rôle. Cette réflexion se propose d’examiner les enjeux liés au droit face aux rapports de force internationaux dans un contexte de crise du multilatéralisme normatif.

« Les alliances, les traités, la foi des hommes, tout cela peut lier le faible au fort et ne lie jamais le fort au faible. Ainsi, laissez les négociations aux Puissances, et ne comptez que sur vous-mêmes »[1]. Ces propos de Jean-Jacques Rousseau retentissent dans nos esprits comme un aphorisme et pourtant ils nous rappellent une vieille réflexion sur la place du droit face au rapport de force dans la sphère internationale. Une réflexion qui demeure d’actualité étant donné les envolées de bouleversements géopolitiques auxquelles on assiste. Les logiques de dominations et de libération ont toujours caractérisé la société internationale mais depuis la deuxième moitié du 20th siècle, on a assisté à travers le droit, à la création de véritables espaces d’humanité, qui quoi qu’imparfaits, ont permis de préserver la paix internationale dans une large mesure. Le droit se présentant comme l’expression de la raison universelle, il s’est ainsi érigé en ordre de mesure de toute chose sur la scène internationale.
Les tensions géopolitiques inédites que nous vivons de plus en plus depuis la fin de la guerre froide, sont le reflet d’une crise de régulation des rapports de forces internationaux. Entre instrumentalisation, déformation, remise en cause, le droit peine à progresser dans la voie de la justice ou de la paix et apparaît de plus en plus comme « un outil idéologique au service du rapport de force déterminé par l’économie », pour reprendre les propos de Karl Max, plutôt que comme un outil de régulation des rapports de force. À titre d’illustration, le persistant conflit israélo-palestinien, la guerre en Ukraine et le conflit à l’Est de la RD Congo, donnent à nouveau à voir que l’inapplication du droit humanitaire demeure un problème majeur dont les conséquences tragiques n’ont de cesse d’être relayées dans les médias. Également, l’inapplication des décisions des juridictions internationales … au nom du droit[2], croit toujours plus fortement. Le droit international se trouve aujourd’hui fragilisé par des logiques d’acteurs et d’actrices très fortement ancrées sur leurs intérêts nationaux et géopolitiques. Il s’agit là d’un fléau social qui manifeste une tension, plus entre le droit et le rapport de force qu’entre le droit et le fait. En outre, les vives tensions diplomatiques entre États sont devenues le quotidien de l’actualité internationale. « Désordre mondial, anarchie, déchaînement de la violence des puissants, crise de légitimité, crise de légalité, crise de gouvernabilité mondiale, crise institutionnelle, crise démocratique, voici les principales caractéristiques de la société internationale »[3], nous faisaient déjà remarquer des auteur·es.
Les institutions internationales et la crise de régulation
La crise de régulation de la société internationale est dans une large mesure, le reflet des conflits d’intérêts et des égoïsmes nationaux qui se conjuguent au sein des institutions chargées de réguler les rapports internationaux et de promouvoir ainsi le droit. Ces institutions sont confrontées aux volontés des États puissants et favorisent, elles aussi, une déstructuration du droit et de l’ordre qu’elles sont censées garantir. À titre d’exemple, « l’ONU, qui devrait être l’élément de contention et de régulation juridique de la force et garante des relations internationales fondées sur la coopération, participe à la conquête du monde menée par les sociétés transnationales avec l’appui des États dominants »[4]. Sous la houlette des États-Unis avec le soutien de ses allié·es, le Conseil de Sécurité des Nations Unies n’a pas hésité à affaiblir l’autorité de la Cour Internationale de Justice et de la Cour Pénale Internationale à travers bon nombre de ses résolutions[5]. Faisant ainsi prévaloir la raison du plus fort plutôt que le droit. Cette instance de l’ONU apparait à l’évidence comme un « organe d’interprétation arbitraire au service des grandes puissances »[6]. Des auteur·es dénoncent d’ailleurs les pratiques des USA et de leurs allié·es au sein de l’organisation comme des postures apparentes de mépris à l’égard du droit international[7]. Ce que Robert Kob considère comme « une attaque frontale contre la Rule of Law internationale »[8]. Le droit international décalque de façon toujours plus persistante les intérêts des puissances. Au demeurant, la crise de régulation observée au sein des institutions internationales érode le multilatéralisme normatif.
L’érosion du multilatéralisme normatif
Le multilatéralisme normatif suppose que les États en s’engageant individuellement se soumettent collectivement à des règles de droit qui par principe ont vocation à maintenir un certain équilibre durable entre les États, entre puissants et non puissants. La tendance à l’unilatéralisme est de plus en plus prononcée, les USA, la Russie et l’État d’Israël en sont les principaux exemples de par l’actualité. Là aussi, il s’agirait d’un unilatéralisme dit au nom du « droit ». Sur des enjeux actuels de construction d’une société plus durable, nous voyons bien que le multilatéralisme ne parvient pas à se déployer pleinement, toute chose qui dans un contexte de mondialisation, entrave également les chances de développement des États non puissants. Les exemples suivants sont assez parlants : la COP21, qui avait suscité beaucoup d’espoir, dont ou retiendra l’aspect purement « déclaratoire », ou encore le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires de 2017, qui n’a été ni signé, ni ratifié par les puissances nucléaires (dont certaines, membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies). Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières de Marrakech en 2018, en est également un bon exemple. Très controversé malgré son aspect uniquement déclaratif, ce dernier suit la forme conventionnelle sans pour autant comporter une quelconque obligation pour les parties[9].
Les défis actuels du droit international sont notables tant en ce qui concerne l’émergence des règles que leur application.
Ainsi, un ordre international qui ne se maintient que par la force, converge inéluctablement vers un ordre dans lequel les règles n’existent que pour les faibles et qui pourrait imploser à tout moment. Dans un tel cadre, le principe de « Pacta sunt Servanda » c’est-à-dire l’exécution de bonne foi des accords librement consentis n’a plus aucune valeur et c’est d’ailleurs le malheureux constat qui peut être fait aujourd’hui, sans être trop alarmiste. Nous nous accordons toutes et tous aujourd’hui pour parler en faveur d’une réforme du système onusien et notamment du conseil de sécurité afin qu’il ne soit plus une instance à la solde des puissances, et cela n’est possible qu’avec les efforts de mobilisation de la société civile. Le traité sur l’interdiction des armes nucléaires est notamment l’aboutissement d’un processus impulsé et soutenu par des organisations de la société civile. Le droit jusqu’à maintenant a tant bien que mal fait ses preuves en tant qu’instrument servant à canaliser les rapports de force internationaux, mais ce droit devient de plus en plus impertinent et contesté. Un exemple de ce constat est la définition de la situation à Gaza où on a pu constater l’imperfection du droit au travers des débats sur le caractère génocidaire de cette situation. Certes le droit n’est pas toujours clair. Cela découle parfois de la volonté des États de s’accorder sur un aspect, mais à charge pour les juridictions qui, elles, sont impartiales, d’y apporter plus de détails. Mais si les décisions des juridictions ne sont pas respectées et qu’un tribunal comme la CPI est qualifié d’antisémite à la suite du mandat d’arrêt émis contre le premier ministre israélien, on peut s’attendre à ce que les défis auxquels le droit international actuel est confronté sont de tout ordre, aussi sensés qu’insensés.
Merlin Fotabong Assoua.
[1] Jean-Jacques Rousseau, Projet de Constitution pour la Corse (nouvelle édition augmentée), Arvensa, 2014, p. 28
[2] Pour reprendre le titre de l’article d’Emanuel Castellarin, « L’inapplication des décisions juridictionnelles internationales… au nom du droit », in L’inapplication du droit, édité par Romain Le Bœuf et Olivier Le Bot, DICE Éditions, 2020, p.217-231.
[3] Mendès France, Mireille. et al. « La dégradation généralisée du respect au droit international ». Revue internationale et stratégique, 2005/4 N°60, 2005. p.43-58
[4] Ibid., p.46
[5] Ibid., p. 47 et s.
[6] Ibid., p. 48
[7] Voir Sarah Pellet, « De la raison du plus fort ou comment les États-Unis ont (ré)inventé le droit international et leur droit constitutionnel », Actualité et droit international, juin 2002.
[8] Robert Kolb, Le droit relatif au maintien de la paix internationale, Paris, Institut de hautes études internationales de Paris, Pedone, 2005, p. 11.
[9] https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/277531-la-crise-du-multilateralisme