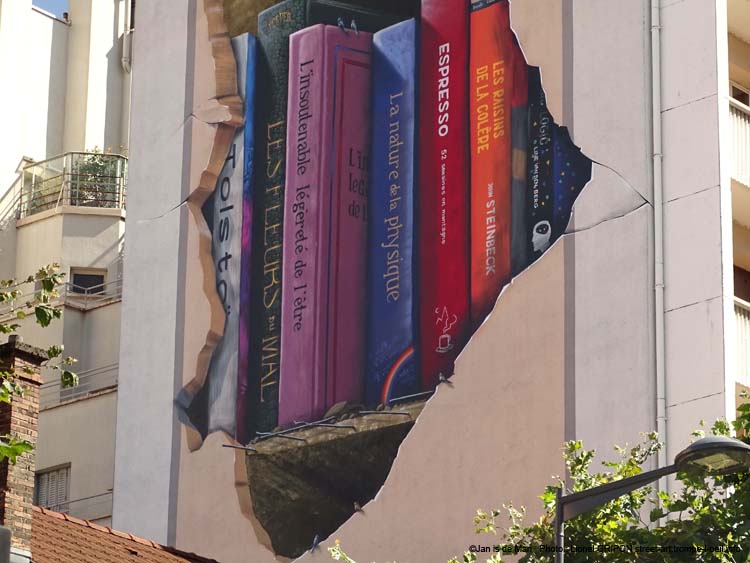Le 30 novembre 2022, OpenAI, une entreprise de la Silicon Valley, met en ligne ChatGPT, fruit de plusieurs mois de travail. Ses chercheur·euses, bien que conscient·es de l’aspect révolutionnaire de leur progéniture, auraient été incapables de prévoir l’impact planétaire que leur création s’apprêtait à avoir. L’âge de l’intelligence artificielle générative grand public était là, et nul ne pouvait plus l’ignorer. Accessible à portée de smartphone, rapide, fluide. Un oracle de poche, capable de répondre à (quasi) toutes nos questions, et qui nous a toutes et tous contraint·es à réfléchir notre rapport même à l’information.

L’IA, nouveau champ de bataille géopolitique
OpenAI n’a pas plus inventé l’IA que les gouvernements du monde entier ne se sont réveillés un matin avec l’envie pressante de soulager leurs penchants militaro-sécuritaires à grands coups d’algorithmes. Depuis sa naissance comme discipline scientifique dans les années 50, les États ont saisi son potentiel, ajustant leurs investissements au fil du temps. Les découvertes récentes font office de piqûre de rappel : investir rapidement et massivement est une nécessité stratégique.
Les modèles d’intelligence artificielle, les processeurs nécessaires à leur entraînement, les technologies de fonte de puces électroniques, ou encore les terres rares qui les composent, constituent autant d’enjeux qu’aucune superpuissance ne peut se permettre d’ignorer. Dans un contexte de dépendance électronique mondiale, de consommation effrénée et d’hybridation des conflits, quiconque en détiendra le monopole pourrait s’imposer comme première puissance mondiale dans la décennie à venir.
Quatre acteurs, deux blocs
Aujourd’hui, de nombreux pays sont à la pointe en matière de recherche et d’applications ciblées mais la géopolitique de l’intelligence artificielle oppose principalement quatre acteurs majeurs : la Russie, la Chine, les États-Unis et l’Europe.
Depuis le virage autoritaire de 2010 et l’invasion de l’Ukraine, la Russie de Vladimir Poutine privilégie une stratégie souverainiste quant à l’IA, avec deux objectifs majeurs. D’une part, alimenter les opérations d’influence étrangère, comme lors d’ingérence électorale ou de campagnes de désinformation en ligne. D’autre part, un tour de vis sécuritaire visant à renforcer son contrôle intérieur sur sa population. L’IA permet, entre autres, au Kremlin le fichage des opposant·es politiques, la détection et la suppression de contenu critique du pouvoir ou encore le ciblage par reconnaissance faciale dans l’espace public.
La Chine, avec son espace numérique clos et la nature autoritaire de son régime, a toujours été pionnière en matière d’utilisation des technologies pour assurer son contrôle politique et opprimer sa population. À l’instar de son allié russe, elle s’emploie à contrôler d’une main de fer l’opinion publique et mène régulièrement des campagnes de désinformation auprès de ses adversaires. La reconnaissance faciale ainsi que le très décrié système de crédit social continuent d’être déployés à grande échelle sur le territoire, et le contrôle algorithmique total de l’information est aujourd’hui une caractéristique emblématique du régime de Pékin. Déterminée à devenir le leader mondial de l’IA d’ici 2030, la Chine développe ses propres processeurs, modèles d’intelligence artificielle, et a dévoilé un plan d’investissement de 138 milliards sur cinq ans visant à renforcer l’autonomie technologique du pays. En parallèle, Pékin via ses “nouvelles routes de la soie numériques” exporte son modèle autoritaire aux régimes alliés et se bat avec les États-unis pour le contrôle de l’infrastructure numérique et l’établissement de normes.
Les États-Unis, soucieux de maintenir leur position dominante, ont annoncé un plan d’investissement de 500 milliards de dollars d’ici 2029 baptisé “stargate”. L’administration Trump promeut l’innovation par l’absence de régulation du secteur, tout en défendant férocement les intérêts privés des compagnies américaines à l’international.
Outre son hégémonie économique et militaire, ce leadership États-unien de l’IA s’explique surtout par un contrôle quasi total de sa chaîne de production. Historiquement pionniers de la recherche, les États-Unis possèdent des entreprises privées à la pointe de leurs domaines respectifs : OpenAI, Microsoft, Meta, Amazon, Intel, Nvidia, etc. Celles-ci disposent des savoir-faire, budget, infrastructures et quantités de données nécessaires à l’entraînement d’IA de pointe.
En parallèle, les États-Unis sécurisent les ressources naturelles nécessaires à leurs ambitions, par exemple en extorquant au peuple ukrainien ses terres rares contre une aide militaire. Enfin, Washington s’efforce de mettre des bâtons dans les roues de son concurrent chinois, notamment par des embargos sur les technologies et équipements de pointe.
L’Europe, forte de ses valeurs, a toujours été en retard sur le plan technologique, malgré la présence d’acteurs stratégiques comme ASML. Consciente des velléités protectionnistes de son allié américain, de ses multiples dépendances et du contexte international, la Commission européenne a annoncé en février un plan d’investissement de 200 milliards d’euros en faveur de l’IA. Aujourd’hui, l’influence du Vieux Continent repose principalement sur sa capacité à établir des normes et à proposer un cadre garantissant les libertés fondamentales de ses citoyen·nes. Après le RGPD en 2018, le règlement européen visant à encadrer l’intelligence artificielle – notamment en interdisant d’emblée certains usages, comme la surveillance de masse – entre progressivement en vigueur. Ce texte, déjà vidé en partie de ses ambitions initiales à la suite d’un intense travail de lobbying, est aujourd’hui menacé d’un « assouplissement réglementaire » au profit de l’innovation, promis il y a peu par la présidente de la commission.
Au regard des équilibres en place et des annonces récentes, force est de constater que la tendance globale est à l’accélérationisme plus qu’à la prudence.
Réuni·es à Paris en février dernier pour le troisième sommet mondial de l’IA, les chef·fes d’État ont à peine abordé les risques, thème majeur des éditions précédentes, obsédé·es par la course technologique et la conclusion de « deal ».
Il ne ressort de cette rencontre que des promesses d’investissement et d’assouplissement législatif, aucun nouvel engagement en faveur de plus de prudence n’ayant été pris. La déclaration finale ne mentionne d’ailleurs le mot « sécurité » que 3 fois.
Quelle gouvernance pour une révolution inévitable ?
L’intelligence artificielle constitue un enjeu stratégique majeur des prochaines années, les impacts sur nos vies et les risques associés sont trop urgents et imprévisibles pour que nos dirigeant·es balayent la question de l’éthique du revers de la main. De la bouche de certain·es expert·es, elle est même la dernière révolution technologique dont l’humanité aura besoin, car elle se chargera elle-même des suivantes.
Loin d’une superintelligence menaçant d’extinction l’humanité — pour combien de temps —, les problèmes techniques et éthiques sont bien réels : biais induits par les données d’entraînement, problèmes d’alignement entre les intentions humaines et les résultats produits, opacité des réseaux de neurones profonds une fois entraînés, mensonges ou tromperies calculés de la part de certaines IA, etc. Ces risques non négligeables exigent notre vigilance collective. De nombreuses voix, dans le monde académique comme dans les sphères politiques, s’élèvent pour réclamer un cadre de gouvernance mondial et appeler à une coopération accrue sur ces enjeux cruciaux.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a donné, en février, le coup d’envoi d’un premier cadre mondial visant à favoriser la transparence, la responsabilité et la comparabilité des pratiques des organisations, afin de promouvoir une intelligence artificielle sûre, sécurisée et digne de confiance.
La création d’instituts de recherche et d’observatoires à travers le monde témoigne d’une volonté commune de s’emparer des nombreuses questions soulevées par cette révolution technologique. Le Centre français pour la sécurité de l’IA a récemment publié un rapport proposant une feuille de route ambitieuse et un programme ciblé pour renforcer la gouvernance mondiale de l’intelligence artificielle.
Toutes ces initiatives à travers le monde sont aussi nécessaires que louables. Afin qu’elles puissent porter leurs fruits, il est désormais essentiel de les traduire en accords internationaux en établissant des normes communes et en veillant à leur stricte application.
Malgré la complexité du sujet, la rapidité avec laquelle l’intelligence artificielle transformera les vies de citoyen·nes du monde entier, dans les années à venir, exige que nous demandions sans délai à nos dirigeant·es la mise en place d’un cadre solide et réfléchi.
À l’heure où notre maison brûle et où un capitalisme à bout de souffle laisse doucement glisser notre monde vers l’autoritarisme, il est de notre responsabilité collective de décider, tant qu’il en est encore temps, quelle forme d’intelligence nouvelle nous voulons intégrer dans nos vies. Puisse-t-elle être au service de l’humanité dans son ensemble, plutôt que de servir des intérêts sécuritaires et économiques au profit de quelques-un·es.
Une fois tous les maux libérés, Pandore laissa l’espérance au fond de sa boîte. La nôtre aujourd’hui ouverte, tâchons d’y trouver la sagesse et le courage nécessaires pour les années à venir.
Oscar Thielen.