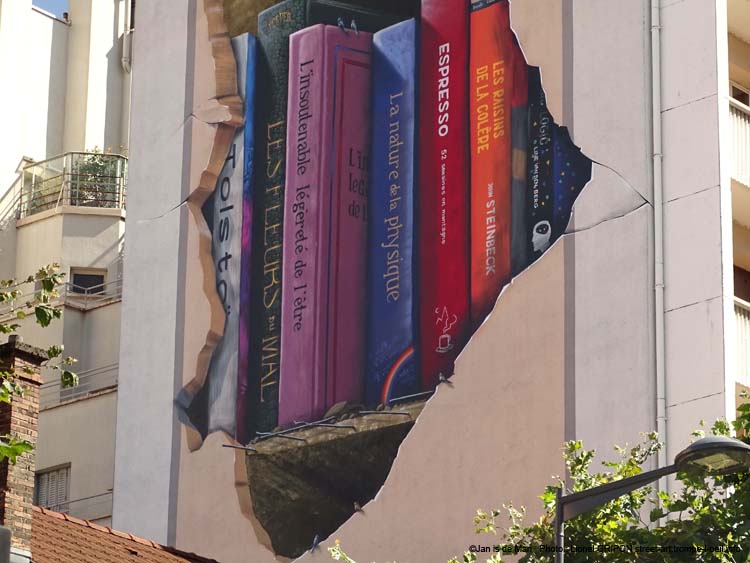La démocratie désigne un mode d’organisation sociale dans lequel le pouvoir est entre les mains de tous·tes les participant·es. L’idéal démocratique est séduisant en principe, mais en pratique il est difficile à mettre en place, surtout à grande échelle. Aujourd’hui, la plupart des nations du monde s’inscrivent dans un modèle de démocratie représentative, c’est-à-dire, un modèle où les citoyen·nes élisent des représentant·es à qui reviennent le pouvoir. Cette analyse propose la visibilisation d’un certain nombre de faiblesses dont fait preuve ce modèle à l’heure actuelle.

L’expérience d’un citoyen belge face aux limites de la démocratie représentative
Je souhaite partir d’une expérience personnelle, non pas parce qu’elle est exceptionnelle, mais au contraire parce qu’elle me semble représentative d’un vécu courant parmi de nombreux·ses citoyen·nes belges. Cette expérience interroge l’accessibilité réelle des espaces démocratiques au quotidien.
Le 13 octobre 2024, je participe pour la première fois aux élections communales dans ma ville de résidence. Dans l’idée d’exercer cette responsabilité citoyenne de manière éclairée, une préparation en amont s’imposait. Malheureusement, dès les premières recherches, il s’avère que les noms figurant sur les listes de candidat·es me sont pratiquement tous inconnus. Cela soulève une première question : comment faire un choix pertinent sans connaître les personnes qui sont en lice ?
Les recherches se poursuivent sur Internet. Certaines listes sans étiquette politique disposent d’une page Facebook, d’autres n’ont aucune présence en ligne. L’attention se porte alors naturellement sur les listes liées aux plus grands partis politiques. Très vite, un sentiment de flou s’installe : au lieu de découvrir des individus et des engagements concrets, l’on trouve des slogans percutants et des positions générales sur les grandes problématiques sociétales, parfois déconnectées des réalités locales.
Le débat de la RTBF entre les président·es des principaux partis wallons suscite rejet et adhésion, sans m’aider à opérer un choix. Le débat semblait davantage refléter la polarisation nationale plutôt que permettre une véritable appropriation citoyenne du scrutin à venir.
Dans mon entourage, les discussions n’étaient pas plus rassurantes. Les personnes interrogées montrent peu d’enthousiasme à échanger sur ce sujet : certaines affichent une lassitude vis-à-vis des promesses électorales, d’autres un désintérêt prononcé, voire une ignorance assumée. Quelques personnes affirment des intentions claires, souvent motivées par tel scandale récent ou par opposition de principe, plutôt que par adhésion réfléchie à un programme.
Le jour du vote, un sentiment d’insatisfaction persiste. Le processus électoral culminait ainsi en un choix de personnes inconnues, que l’on ne rencontrerait peut-être jamais, sur la seule base d’une affiliation politique. Un choix sans nuance et sans garantie.
Selon moi, cette expérience révèle les limites d’un système représentatif où l’information est fragmentée, l’engagement souvent impersonnel, et la participation réduite à un acte ponctuel, déconnectée d’un dialogue continu entre élu·es et citoyen·nes.
Représenter versus représenter
Une nuance fondamentale à apporter à cette discussion porte sur la double signification de la représentation. D’une part, il y a la représentation en tant que rôle, celui attribué par les électeur·rices. Et d’autre part, il y a la représentation en tant que qualité, on pourrait parler de représentation effective, pour signifier le degré de fidélité avec lequel un·e représentant·e joue son rôle.
Dans l’idéal du modèle de la démocratie représentative, les électeur·rices choisissent des représentant·es qui leur ressemblent. En effet, nous nous sentons habituellement prêt·es à déléguer du pouvoir aux personnes auxquelles nous nous identifions, puisqu’elles défendent, en principe, les mêmes valeurs et les mêmes intérêts.
En pratique, cet objectif est difficile à atteindre, surtout lorsque la fonction de représentation se joue à une échelle importante. Deux obstacles majeurs se présentent. Le premier est que dans le monde globalisé d’aujourd’hui, la pluralité des communautés locales est probablement plus grande qu’elle ne l’a jamais été, et toute action menée affecte potentiellement le monde entier, en raison de la complexité des liens qui existent entre les nations. Il est donc impossible, même pour une poignée de personnes bien choisies, de bien refléter la totalité des identités et des intérêts. Le second est que les personnes qui trouvent les opportunités d’exercer une fonction de représentation à grande échelle appartiennent généralement à des tranches de population aisée, avec un niveau d’éducation important, et bénéficiant souvent encore d’autres avantages innés ou liés à leur environnement. Ces personnes perdent ainsi en légitimité aux yeux d’un nombre important de minorités, en particulier des plus défavorisées.
L’imperfection de la représentativité effective est un compromis faisant partie du contrat de la démocratie représentative, mais cela doit rester un objectif à poursuivre. En Belgique, par exemple, il reste encore beaucoup de marge de progression. Rappelons à cet égard que la présence des femmes au sein des organes politiques au cours des 30 dernières années (bien qu’en hausse suite aux élections de 2024) ne reflète pas leur proportion au sein de la population. Et on ne peut pas dire qu’il s’agit là d’une minorité ![1]
L’influence des réseaux sociaux
Une nouveauté dans le paysage politique de ces dernières années est le développement de la présence politique en ligne. Dans son ouvrage « Les ingénieurs du chaos », Giuliano da Empoli décrit plusieurs mécanismes sous-jacents à la montée des extrêmes partout dans le monde, et met en lumière l’utilisation stratégique des réseaux sociaux.
Le principe est assez simple à expliquer. Sur la plupart des plateformes populaires, comme par exemple X (anciennement Twitter), Instagram, TikTok or YouTube, les utilisateur·rices se voient conseillé·es en matière de contenu par des algorithmes de recommandation. Ces algorithmes sont optimisés pour avoir le meilleur taux de rétention d’audience, puisque la plupart de ces plateformes sont gratuites, et font profit sur base de la publicité. On comprend ainsi l’intérêt qu’elles ont à maintenir leurs consommateur·rices connecté·es autant que possible.
Une recommandation de contenu pertinente augmente évidemment le taux de rétention, mais il s’avère que le contenu suscitant des réactions émotionnelles fortes engendre beaucoup plus d’engagement. Par exemple, une affirmation controversée fera l’objet de plus de commentaires. Par ailleurs, plus le contenu est inflammable, plus il se propage rapidement. Aujourd’hui, ces algorithmes ont une tendance désormais bien connue : tourner les utilisateur·rices vers du contenu « extrême ».
Deux conséquences immédiates de ce mécanisme sont les suivantes. D’une part, le contenu extrême est survisibilisé, et les personnes se retrouvent facilement enfermées dans des bulles consensuelles à l’intérieur desquelles cela semble tout à fait acceptable. D’autre part, cela ouvre la porte à une stratégie de ciblage électoral. Un parti politique peut par exemple diffuser du contenu fabriqué sur mesure pour différents types de profils d’internautes, bien que le discours global soit en contradiction totale. Cela permet notamment à des formations politiques aux valeurs extrêmes de rallier des communautés bien précises à leur cause, comme l’exemple des gamers aux États-Unis.[2]
Il est important de rappeler que ce n’est pas la première fois qu’une technologie affecte la perception individuelle du paysage politique. La presse écrite, par exemple, a été la référence en matière d’information et de communication politique pendant très longtemps. La nouveauté aujourd’hui se trouve peut-être dans le volume et la vitesse avec laquelle circule l’information.
Les nouveaux contestataires
S’ajoute à cela l’apparition de nouveaux contestataires, qui profitent de la fragilisation de la démocratie représentative. Partout en Europe, l’on assiste à une montée du nationalisme, qui se légitime en revendiquant qu’il représente une majorité de la population. C’est un positionnement délicat puisqu’il tente de légitimer de nouvelles formes de violence et de répression des minorités au nom de la démocratie. Ce rapport de pouvoir de la majorité est en contradiction avec l’essence même de la démocratie, et de mauvais augure. Comme le disait si bien Albert Camus, « La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité ».
Aux États-Unis, c’est la figure emblématique du président Donald Trump qui incarne la nouvelle vague de contestation de la démocratie. On se souvient par exemple de la tentative de prise de la Maison-Blanche le 6 janvier 2021 par ses supporteur·rices, suivant sa défaite aux élections présidentielles quelques semaines auparavant. Il maintenait en public un discours selon lequel le résultat des élections avait été manipulé en sa défaveur. Cet exemple est frappant, étant donné que les États-Unis figurent parmi les nations historiques ayant défendu la démocratie.
Depuis sa ré-investiture le 5 janvier 2025, il semblerait qu’une libération de la parole s’opère partout dans le monde, en dépit des progrès en matière de protection sociale. Il en résulte un rejet de l’espace démocratique, puisque les minorités ne sont pas effectivement représentées, et que leur écrasement se fait au nom d’une majorité désintéressée.
Comment restaurer la démocratie ?
L’enjeu est de taille, surtout à l’échelle des nations. Il faut prendre soin des espaces authentiquement démocratiques, et cela commence déjà à l’échelle locale. Se réapproprier ces espaces est aussi l’occasion pour les jeunes citoyen·nes européen·nes qui n’ont pas connu les régimes autoritaires du 20th siècle de prendre conscience de la fragilité de la démocratie, et du fait que l’on ne peut jamais la prendre pour acquise.
Il me semble que l’action sociale est un moyen crucial pour maintenir une démocratie représentative. À une époque où nous sommes de plus en plus isolé·es, il faut redoubler d’efforts pour continuer d’inclure les minorités dans les espaces de citoyenneté dont elles sont trop souvent exclues. Une vraie prise de conscience des difficultés rencontrées par ces personnes exige d’aller à leur rencontre et de faire preuve de solidarité.
Il est de la responsabilité de la majorité de faire entendre la voix des personnes oubliées, et de renoncer au confort que leur confèrent les nouveaux rapports de force.
Alex Loué.
[1] https://igvm-iefh.belgium.be/fr/themes/prise-de-decision-politique/chiffres
[2] https://edition.cnn.com/2025/03/23/us/gamergate-harassment-reddit-twitter-cec