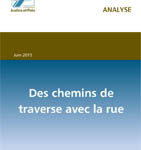À Bruxelles, en 2014, plus ou moins 2600 personnes vivaient dans la rue, de façon quotidienne, selon La Strada[1]La Strada est le centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri.. Sur le trottoir, sous les ponts, dans le métro, les parcs, à l’entrée de commerces, à l’intérieur des halls de gare, les habitants de la rue sont omniprésents dans notre environnement immédiat. Nous les côtoyons tous les jours à travers nos déplacements et pourtant, un fossé immense semble les séparer de nous.
Documents joints
Notes[+]
| ↑1 | La Strada est le centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri. |
|---|---|
| ↑2 | BEGOUT, Bruce, Chroniques mélancoliques d’un vendeur de roses, nouvelle issue du recueil L’accumulation primitive de la noirceur, Éditions Allia, p.200. |
| ↑3 | ECHENOZ, Jean, Un an, Éditions de Minuit, p. 11. |
| ↑4 | MACCANN, Colum, Les saisons de la nuit, Éditions 10/18, p. 14. |
| ↑5 | Id., p.56. |
| ↑6 | Paroles de Georges Brassens issues de la chanson Le temps passé. |
| ↑7 | ECHENOZ, Jean, Ibid, p.62. |
| ↑8 | La Strada parle d’une augmentation de plus de 30 % depuis l’année 2010. |
| ↑9 | DECLERCK, Patrick, Les naufragés, Terre Humaine, p.139. |
| ↑10 | www.toutautrechose.be mouvement citoyen de solidarité belge. |