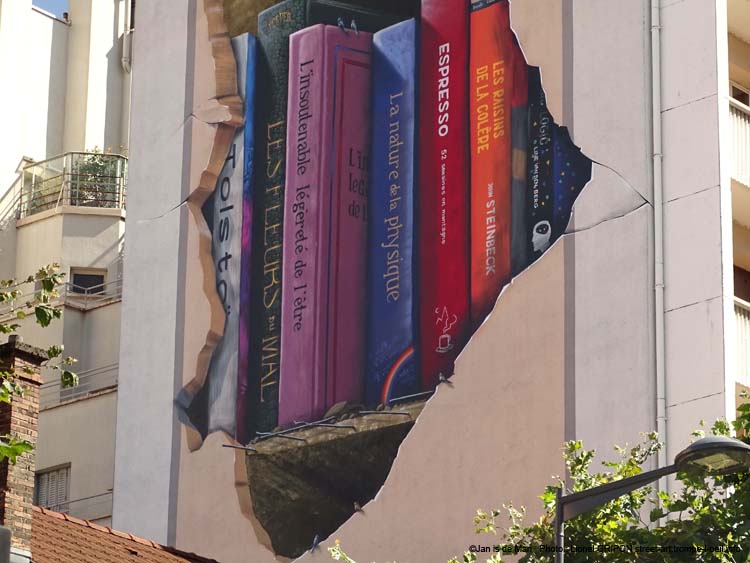Les terres rares sont des matières premières, indispensables au développement des technologies dites vertes, les « greentechs » tels que les éoliennes et les panneaux solaires. Mais quelles sont les conséquences de leur exploitation ?
- Guillaume Pitron, La guerre des métaux rares : la face cachée de la transition énergétique et numérique, Les Liens qui Libèrent, 2018.
- Gilles Lepesant, La transition énergétique face au défi des métaux critiques, Ifri www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/etude_lepesant_transition_2018_complet.pdf
- Jim Ritter, L’érosion du sol – Causes et effets, 10/2012, www.omafra.gov.on.ca/french/engineer/facts/12-054.htm
- Renato Pinto et Jean-Yves Buron, Vivre ensemble, Initiatives citoyennes : et le politique dans tout ça ?, 2016, https://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2016-11_initiatives_citoyennes-politique.pdf
- Bureau d’étude géologique et environnementale, BEGE-RDC, Dégradation de sol par l’érosion: causes, conséquences et mesures préventives, 2016, http://bege-rdc.e-monsite.com/blog/environnement-et-developpement-durable/degradation-de-sol-par-l-erosion-causes-consequences-et-mesures-preventives.html